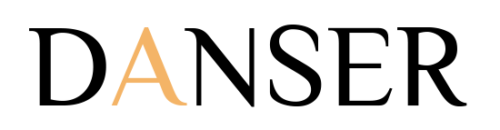Guido Reni, Sainte Dorothée, Royaume-Uni, collection particulière, (courtoisie Robilant + Voena,) 83 X 79 cm.
Natif de Bologne, l’un des principaux foyers artistiques du XVIIe siècle, Guido Reni (1575-1642) se forma à la peinture dans sa cité natale, avant de se rendre à Rome en 1601, où il perfectionna son art au contact des œuvres de Raphaël ou du Caravage. Dans la Ville éternelle, Reni devint l’un des artistes les plus renommés, obtenant des commandes de personnalités toujours plus importantes, jusqu’au pape Paul V. Il retourna à Bologne en 1614, où il dirigea un atelier de réputation internationale. Éclipsé ensuite par des artistes contemporains tels que Caravage, Pieter Paul Rubens ou Nicolas Poussin, Reni bénéficie désormais d’un regain d’intérêt, étant reconsidéré – à juste titre – au premier rang des peintres européens de son temps : une exposition à la galerie Borghèse de Rome en 2022, une grande rétrospective au Städel Museum de Francfort et au musée du Prado de Madrid en 2022-2023, ou encore son chef-d’œuvre « Hippomène et Atalante » (Naples, musée de Capodimonte) accroché temporairement dans la Grande Galerie du musée du Louvre en 2023-2024. Si un nouvel évènement consacré à l’artiste avait pu apparaître aussi bourratif qu’un repas de fêtes de fin d’année, le musée des Beaux-Arts d’Orléans se mue en providentiel père Noël, parvenant à traiter avec brio d’une facette nouvelle et originale du peintre, son atelier.
Corentin Dury, commissaire de l’exposition, élabora cette manifestation à partir de la redécouverte récente d’un chef-d’œuvre du musée des Beaux-Arts d’Orléans. Il l’intègre plus largement dans un minutieux et important travail sur les œuvres de Reni et son atelier conservées dans les collections publiques françaises, comme « l’Enlèvement d’Europe » récemment restaurée (Tours, musée des Beaux-Arts). Cette exposition permet au public de comprendre les enjeux et le fonctionnement d’un grand atelier de peinture durant l’époque moderne. Un programme aussi pointu qu’alléchant, parfaitement servit par des textes de salle érudits et accessibles. La scénographie, réalisée par Nathalie Crinière et Maëlys Chevillot, est réussie, sachant à la fois cloisonner les différentes idées fortes tout en faisant dialoguer les œuvres, provenant de prestigieuses collections publiques et particulières de toute l’Europe.
L’exposition l’annonce d’emblée, elle ne s’intéresse pas seulement à Reni, mais au fonctionnement de son atelier, espace social et de travail où se retrouvaient plusieurs dizaines d’élèves et collaborateurs. Comme le rappelle Corentin Dury, les ateliers de grands peintres fonctionnaient alors comme une maison de haute couture aujourd’hui : des « projets d’exception étaient exécutés par le chef d’atelier, des créations sur mesure parfois en collaboration avec d’autres peintres, des pièces de réédition par des collaborateurs d’envergure ou encore une gamme de « prêt-à-accrocher » par des assistants ». C’est à la diversité de ces facettes que le public est confronté dès la première salle.
Une figure d’expression représentant le Suicide de Lucrèce (Rome, musée capitolin), inachevée à la mort de Reni, illustre la manière de travailler en atelier : après avoir préparé la toile pour mieux faire ressortir les effets de lumière et de couleurs finaux, la figure est esquissée, tandis que les premiers coups de pinceau construisent les volumes à travers les jeux d’ombres et de lumière. Si cette peinture fut réalisée par Reni, la plupart des œuvres étaient généralement préparées par l’atelier, avant que le maître ne vienne apposer des « ritocchi » (retouches), comme dans la Judith tenant la tête d’Holopherne, (Chartres, musée des Beaux-Arts).
Devenu l’un des peintres les plus sollicités de son temps, Reni recourut à son atelier pour répondre à une demande de plus en plus forte. Parmi les stratégies commerciales mises en place, la copie de ses œuvres par ses élèves fut une pratique courante. La copie s’intégrait naturellement dans le processus de formation des jeunes artistes. Reni lui-même copia abondamment lorsqu’il apprit son métier, comme le présente une section de l’exposition, où des dessins et gravures de l’artiste sont mis en parallèle de feuilles des Carracci, de Parmigianino ou de Denijs Calvaert, le maître de Reni.
Par la suite, Reni se servit de son atelier pour décliner ses œuvres célèbres, qui étaient vues et désirées par une clientèle plus large. Orléans présente trois petits cuivres de même composition, figurant la Rencontre de Jésus et de saint Jean-Baptiste, mais de mains différentes, tantôt par celle du maître, tantôt par des collaborateurs plus ou moins talentueux. L’accrochage des œuvres côte à côte permet au visiteur d’observer les différences de qualité, et de se prêter au jeu de l’attribution de manière didactique.
L’exposition rappelle également que si Reni se servait de son atelier pour répondre à de telles demandes, le peintre savait aussi anticiper les commandes. Lorsqu’il acheva son Saint Michel Archange pour l’église des Capucins de Rome, il envoya son collaborateur et excellent copiste, Ercole di Maria, ouvrir un atelier à proximité de l’édifice pour exécuter des répliques. L’idée de pièce unique au profit d’un intérêt commercial s’estompe dans de tels cas.
L’exposition montre également d’autres pratiques de l’atelier de Reni aussi remarquable d’un point de vue esthétique que commercial. D’une grande peinture destinée à orner l’autel d’une église, le peintre savait en extraire un personnage à l’expression marquante, qu’il faisait copier par son atelier, afin de le diffuser plus largement, plus rapidement et à un prix inférieur. La figure tragique et douloureuse du Christ provenant de la Crucifixion des Capucins (Bologne, pinacothèque) fut multipliée en d’innombrables versions indépendantes, le grand format spectaculaire se transformant alors en petit cuivre de dévotion privée. De telles œuvres permettaient à une clientèle particulière d’avoir un « morceau » d’un tableau célèbre se trouvant dans un espace public. Reni pouvait également s’appuyer sur ses modèles pour varier les figures saintes, s’adaptant ainsi au saint patron d’un client aisé, ou d’une église.
Reni usa tant de cette méthode qu’il en subit les critiques de certains contemporains ! On pouvait lui reprocher un risque de confusion des scènes religieuses par l’utilisation de figures devenant communes et interchangeables, sinon un « travestissement » des saints au nom d’intérêts commerciaux. Le modèle de la jeune martyre dans la remarquable Sainte Dorothée, exposée (collection privée), est tiré d’une servante de l’ambitieux Triomphe de Job, conservé à la cathédrale Notre-Dame de Paris (récemment restauré et présenté à l’exposition « Grands décors restaurés », au Mobilier national). Ce cas peut également rappeler à la même époque certains tableaux du Caravage refusés par leur commanditaire, car des personnes de basse condition sociale étaient prises en modèle pour représenter les personnages saints du tableau. Ces exemples renvoient au contexte de création artistique au début du XVIIe siècle, et à la réception directe des images religieuses ayant un but spirituel et idéologique important durant la Contre-Réforme, dans un environnement bien différent de notre délectation des tableaux au musée à notre époque.
Le spectateur a l’occasion de voir dans cette exposition de nombreuses œuvres des collections publiques françaises, parfois sorties des réserves pour l’occasion, ou provenant d’importantes collections particulières, mais également des peintures des plus beaux musées du monde. Du Kunsthistorisches Museum de Vienne, le Saint Pierre vient exemplifier une problématique immuable à la production en série d’œuvres exécutées par des artistes différents de l’auteur original, la question de l’authenticité. Déjà au XVIIe siècle, les clients cherchaient à obtenir des garanties sur les œuvres se trouvant sur le marché de l’art, et ce Saint Pierre fut l’objet d’un certificat d’authenticité par Reni lui-même, confirmant qu’il l’avait peint. D’autres personnes se firent tromper, sinon escroquées, comme Louis XIV ! Une Charité romaine présentée dans l’exposition, aujourd’hui attribuée à Giovanni Giacomo Sementi et conservée au musée des Beaux-Arts de Marseille, fut vendue comme de la main de Reni à la Couronne de France peu après la mort du peintre.
Si cet exemple provient d’une malhonnêteté de la part du vendeur, d’autres cas présentés par l’exposition témoignent de problématiques liées à l’originalité des œuvres dès leur conception. Un tableau d’autel exécuté par Giovanni Maria Tamburini, figurant une Annonciation (Bologne, église Santa Maria della Vita), et mis en parallèle de dessins de la Vierge Marie et l’ange Gabriel, exécutés par Reni (Florence, galerie des Offices). Le spectateur peut se rendre alors immédiatement compte que le premier, élève de Reni, tira ses figures saintes des modèles imaginés et griffonnés par son maître. S’il s’agit ici d’un « emprunt » validé certainement par Reni qui donnait lui-même ses feuilles à certains collaborateurs, l’exposition rappelle que d’autres membres de l’atelier se faisaient payer la nuit pour ouvrir l’atelier du maître, et permettre à certains artistes peu scrupuleux de copier les œuvres réalisées ou en cours d’exécution !
La fin du parcours de l’exposition s’intéresse à la production en série d’œuvres issues de l’atelier de Reni, à travers deux peintures des collections du musée d’Orléans. La Sainte Marie-Madeleine, réalisée par un collaborateur du maître bolonais, s’inscrit dans un corpus dense, car apprécié de l’élite romaine. Accroché à côté, un tableau similaire (galerie Serti), au format légèrement plus grand permettant de faire apparaître la sainte en pied et non en buste, fut exécuté de la main de Reni comme le révèle l’exceptionnelle finesse d’exécution. Cette seconde œuvre fut certainement exécutée pour un client aussi prestigieux qu’aisé, peut-être l’un des membres de la célèbre famille Barberini qui possédaient quatre Marie-Madeleine de Reni. Le manque de descriptions précises dans les archives empêche de retracer précisément l’historique des œuvres, ce qui pourrait permettre d’en authentifier certaines. L’exposition revient remarquablement (et courageusement) sur cette problématique rencontrée par les historiens de l’art, permettant au visiteur de comprendre à la fois les méthodes de travail des spécialistes, et de leur présenter ces recherches permanentes, pouvant être remises en question à chaque nouvelle découverte.

Guido Reni, ou collaborateur, la rencontre de Jésus Christ et de Saint Jean Baptiste,
huile sur cuivre, 38 x 27,3 cm. Niort, musée Bernard d’Agesci.
Ces recherches et découvertes s’illustrent parfaitement dans ce qui est le point d’orgue de l’exposition, la section consacrée au David vainqueur de Goliath d’Orléans. Ce grand tableau ne fut jamais oublié ; sa provenance est même bien connue, retracée dans l’exposition à travers des tablettes numériques, permettant d’associer des documents d’archives numérisés avec des textes explicatifs.
Passée par de grandes de collections privées (Particelli, La Vrillière), l’œuvre rentra dans les collections nationales durant la Révolution française, avant d’être inscrite sur l’inventaire du musée du Louvre. Parce que ce dernier conservait un autre David vainqueur de Goliath provenant des collections royales, le tableau Particelli/La Vrillière fut alors « relégué » au rang de copie, et envoyé dans un musée de province – Orléans en 1872 – sanction suprême que peut connaître une œuvre en France … Après une salutaire restauration en 2018 par l’atelier Arcanes, le David d’Orléans fut reconsidéré comme une œuvre de la main de Reni, et fut présenté en grande pompe dans la dernière exposition rétrospective consacrée à l’artiste à Francfort et Madrid (2022-2023).
Exposition dans l’exposition, le musée présente les dernières recherches consacrées au tableau après sa spectaculaire restauration. Le premier pan de salle s’intéresse à la culture visuelle de Reni, afin d’identifier de potentielles sources d’inspiration, comme un antique populaire, décliné notamment par l’Antico durant la seconde moitié du XVIe siècle. Le David d’Orléans est ensuite présenté aux côtés d’autres versions de David plus ou moins variées, afin de montrer aussi bien la popularité du héros biblique dans l’art du XVIIe siècle que les formidables capacités d’invention de Reni. La version, singulière, du musée d’Urbino, touche par le caractère charnel et juvénile de David, dont la représentation n’est pas sans rappeler celle de saint Jean-Baptiste. Une toile d’une typologie encore mystérieuse, ayant appartenu au cardinal de Richelieu, est également rappelée. Quant au fameux tableau du Louvre, qui ne s’est pas déplacé sur les bords de la Loire, il est présenté par une photographie à l’échelle. Le visiteur peut se rendre compte de la similarité des deux toiles, mais peut aussi saisir deux différences importantes en étant attentif. Si le Goliath du Louvre regarde vers l’extérieur, celui d’Orléans est tourné vers l’intérieur, comme c’est également le cas dans le seul dessin préparatoire connu pour cette typologie d’œuvre, présenté dans la salle (Preston, Art Gallery). De plus, une photographie infrarouge du tableau orléanais dévoile de nombreuses reprises, non présentes dans l’œuvre parisienne, laissant supposer qu’il s’agit là de la version initiale, et que celle du Louvre fut réalisée après !
L’exposition se conclut sur l’importante fortune de l’œuvre, reprise par les contemporains de Reni comme Giovanni Battista Caracciolo (Rome, galerie Borghèse), jusqu’aux peintres français de la fin du XVIIIe siècle, comme Jean-Jacques Lagrenée (Caen, musée des Beaux-Arts). Par la suite, l’importance de Reni, si elle ne s’estompa jamais, diminua, comme le signalait Jean Joseph Taillasson en 1807 : « pendant quelque temps l’École française le regarda comme le peintre le plus parfait : aujourd’hui peut-être on ne lui rend pas assez de justice ». L’exposition d’Orléans vient de la rendre avec brio. Benjamin Esteves
Jusqu’au 30 mars 2025. Commissaire : Corentin Dury, conservateur du patrimoine en charge des collections d’art ancien au musée des Beaux-Arts d’Orléans. Catalogue co-édité par le musée des Beaux-Arts d’Orléans et Silvana Editoriale. 39 €, 120 pages, 117 illustrations. Sous la direction de Corentin Dury, avec de nombreux essais d’historiens de l’art français et étrangers.
Nombreuses visites et ateliers pour enfants et adultes.